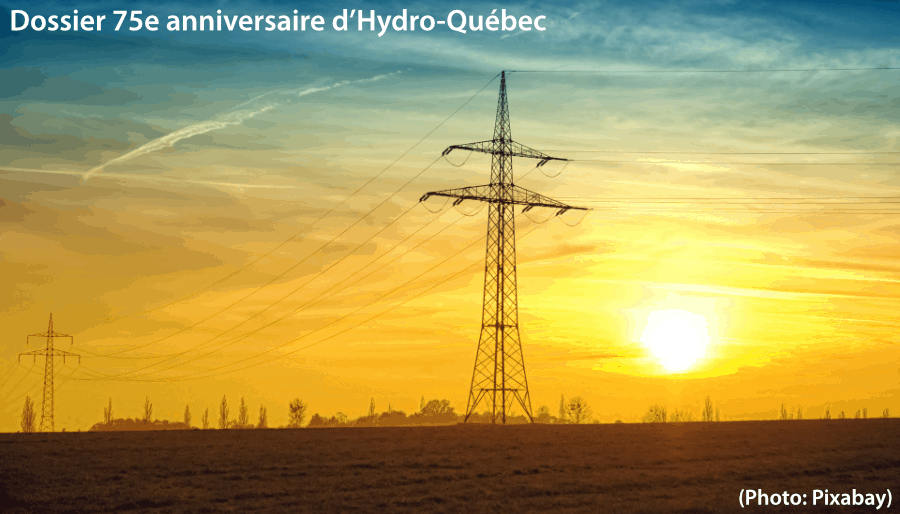
Il est rare que le développement d’un projet – barrage, ligne de transport d’énergie, parc éolien ou solaire – susceptible de défigurer un paysage autrefois vierge fasse l’unanimité. Hydro-Québec mène des consultations et change ses tracés au gré de celles-ci, mais à certains moments la grogne populaire persiste, comme à Saint-Adolphe-d’Howard, où se construit la ligne Grand-Brûlé – Dérivation Saint-Sauveur à 120 kV.
L’acceptabilité sociale est un enjeu important. C’est entre autres en rencontrant les militants de Saint-Adolphe-d’Howard pour un reportage que Julie Barlow a eu l’idée d’écrire avec Jean-Benoît Nadeau un livre sur les défis d’Hydro-Québec. «Il sera de plus en plus difficile pour Hydro-Québec de faire accepter des nouveaux tracés», soulève Julie en soulignant que les médias sociaux et les nouvelles technologies aident les militants à mobiliser leur communauté.
«La population augmente. Celle de Saint-Adolphe-d’Howard a doublé par rapport à celle du Québec [et des Laurentides] depuis 2001. Ça ne se fait pas sans forcément changer le paysage», remet en perspective le journaliste Jean-Benoît Nadeau. L’enfouissement de ligne serait une solution, «bien qu’Hydro-Québec n’ait pas été capable de chiffrer combien il en couterait», glisse-t-il, mais il faudrait investir de l’argent. «C’est un choix de société», résume-t-il.
Cependant, bien qu’on entende haut et fort les opposants, Hydro-Québec construit tout de même 200 à 400 km de nouvelles lignes par années, souvent sans un souffle de critique.
Première à réaliser des études environnementales
Dès son embauche en 1972, Roger Lanoue, ex-vice-président Recherche et planification stratégique, se rappelle avoir été animé par la protection de l’environnement et un souci d’impliquer les populations locales pour «éviter les saccages inutiles». «Les ingénieurs me traitaient de fleuriste, se souvient-il, mais je tenais à connaître le point de vue environnemental et les impacts biophysiques des projets ainsi qu’à interagir avec les citoyens qui connaissent leur milieu.»
Il a pris part aux premières études d’impact visant à évaluer un projet et a notamment collaboré à la localisation des deux premières lignes du complexe de la Baie-James. Hydro-Québec est ainsi devenue l’une des premières sociétés en Amérique du Nord à réaliser des études d’impact environnemental, entre 1971 et 1973, alors qu’aucune loi canadienne ni québécoise ne servait à protéger l’environnement. «On a ainsi contribué à créer un vocabulaire environnemental au Québec qui n’existait alors qu’aux États-Unis», indique M. Lanoue.
Pionnière en matière d’efficacité énergétique, Hydro-Québec a intégré un dispositif de récupération de la chaleur pour le chauffage de son siège social dès sa construction en 1962. Le système puisait son énergie de la chaleur dégagée par les transformateurs du poste Dorchester, situé juste derrière le siège social, un système encore fonctionnel aujourd’hui.
Pour poursuivre la lecture de ce dossier, voir les articles de cette édition portant sur le centre de recherche d’Hydro-Québec, les nouvelles sources de revenus et opportunités pour rentabiliser les infrastructures, ainsi que l’historique de la société d’État.
![]()
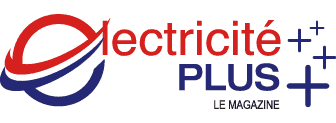
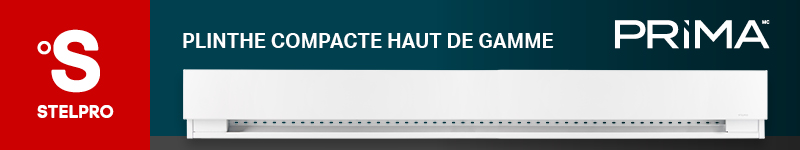
Laisser un commentaire